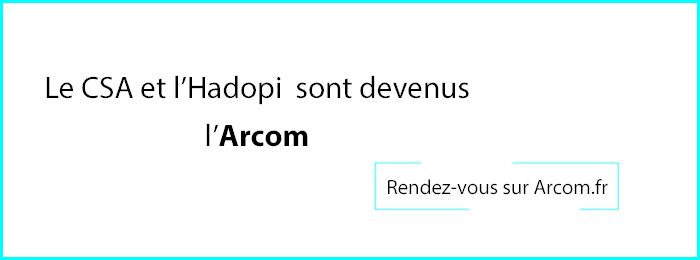Par décision du 20 octobre 2004, le Conseil d'Etat a annulé les autorisations délivrées le 10 juin 2003 pour l'exploitation en TNT des services à vocation nationale suivants : i-Télé, Sport+, Planète, Ciné-Cinéma Premier, Canal J et iMCM. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel envisage de lancer un appel aux candidatures, sous réserve de la confirmation par le Conseil d'Etat, saisi sur les mesures d'exécution appelées par la décision d'annulation, de la validité juridique d'un tel appel. Celui-ci porterait sur la ressource radio-électrique rendue disponible du fait de cette décision. C'est dans cette perspective que s'ouvre la présente consultation.
Avant d'apporter des précisions sur l'objet de la consultation, le CSA souhaite rappeler le contexte dans lequel celle-ci s'inscrit et identifier les évolutions principales intervenues depuis la sélection du 23 octobre 2002.
1 - Les étapes de la mise en place de la TNT
Les principales étapes de préparation du déploiement de la télévision numérique terrestre ont été les suivantes.
Le cadre juridique de la TNT
Le cadre juridique de la TNT a été fixé par la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986. Une fois exercé le droit de priorité dont bénéficie le secteur public pour le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de ses missions, la loi charge le CSA d'autoriser les autres services à l'issue d'un appel aux candidatures.
Un droit de reprise en numérique des services autorisés avant le 1er août 2000 est prévu, ces mêmes éditeurs bénéficiant en outre d'un droit pour un service supplémentaire de télévision à vocation nationale.
La planification des fréquences
Ce processus a débuté en septembre 2000 par une consultation sur la stratégie de planification à adopter pour la TNT. Cette consultation a conduit le CSA à décider de déployer la TNT par l'utilisation prioritaire du réseau de 110 sites "points hauts" exploités pour la télévision analogique, dans les mêmes bandes de fréquences que celles qui lui sont allouées. Cette option est apparue comme optimale en terme de délais de déploiement et de coûts.
Conformément à ces orientations, le CSA a entrepris la planification des fréquences du réseau numérique en associant à chaque site d'émission 6 fréquences, ou multiplex, qui constitueront 6 réseaux nationaux. Cette planification s'est poursuivie et les fréquences relatives à 88 sites ont été publiées, correspondant à une couverture de 68 % de la population environ. Les données relatives aux autres sites seront publiées avant la fin de 2005, pour aboutir à une couverture à terme de 80 à 85 % de la population métropolitaine.
L'appel à candidatures pour l'édition de services TNT
à vocation nationale
Le CSA a lancé, le 24 juillet 2001, un appel à candidatures pour les services nationaux de la TNT. Après une phase d'étude individuelle des dossiers, il a auditionné les candidats recevables, entre le 17 juin et le 1er juillet 2002.
Le 23 octobre 2002, le CSA a publié sa sélection de 23 chaînes (21 services à temps complet et 2 services en canal partagé). En tenant compte des chaînes de service public qui en raison de leur droit de priorité ne participaient pas à l'appel et des services privés en faveur desquels la loi a prévu un droit de reprise intégrale et simultanée sur le numérique hertzien, la sélection du CSA a conduit à offrir 15 chaînes payantes et 14 chaînes gratuites.
Chaque candidat a conclu avec le CSA une convention de diffusion d'un service TNT et les autorisations de diffusion ont été délivrées à l'ensemble des éditeurs le 10 juin 2003.
Les étapes suivantes
En octobre 2002, à l'issue de la sélection des candidats, le CSA a publié un premier projet de répartition des services de télévision sur les 6 multiplex en regroupant les chaînes privées sur 4 d'entre eux.
Les projets de composition des 4 multiplex réservés aux chaînes privées ont été soumis à de nombreuses discussions avec les éditeurs de services. La composition de ces multiplex a été arrêtée le 10 juin 2003.
En application des délais prévus par la loi, les éditeurs de services ont procédé à la désignation des opérateurs de multiplex dans le délai de deux mois après la délivrance des autorisations, soit le 11 août 2003.
Le CSA a autorisé le 22 octobre 2003 les opérateurs des 4 multiplex des chaînes privées et leur a affecté des canaux de diffusion.
Les services du secteur public avaient été quant à eux répartis à l'origine sur deux multiplex. Le 17 décembre 2003, le ministre de la Culture et de la Communication informait le CSA que, sur les 3 canaux prévus initialement, un seul ferait l'objet du droit de priorité accordé au secteur public et exprimait le souhait que l'ensemble des chaînes de service public soient regroupées sur un multiplex unique, ce que le CSA a décidé le 27 janvier 2004.
De ce fait, le 24 février 2004, le CSA a lancé une consultation portant sur l'utilisation du multiplex R5 rendu totalement disponible. La synthèse des réponses à la consultation a été publiée le 9 juin 2004. Compte tenu de la diversité des projets présentés (chaînes nationales, chaînes locales, télévision haute définition, réception mobile), le CSA a souhaité approfondir ces différentes demandes et propositions avec les acteurs concernés.
Le 8 juin 2004, le CSA a fixé officiellement la date de début des émissions de la TNT. Celle-ci est fixée au 1er mars 2005 pour les services gratuits et au 1er septembre 2005 pour les services payants. Ce départ s'effectuera sur 17 sites de diffusion, couvrant 35 % environ de la population. Le CSA estime que six mois après le démarrage, 50 % de la population devrait être couverte.
Plus récemment, une consultation sur la numérotation des chaînes de la TNT a été menée et ses résultats seront publiés prochainement.
2 - Principales évolutions récentes
La sélection des 23 chaînes en octobre 2002 a été effectuée en tenant compte notamment de l'article 30-1 III de la loi de 1986 modifiée qui dispose que "dans la mesure de leur viabilité économique, notamment au regard de la ressource publicitaire, le CSA favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus".
L'analyse des dossiers a conduit le CSA à privilégier un équilibre entre le nombre d'autorisations délivrées pour des services payants et le nombre d'autorisations délivrées pour des services gratuits. Du point de vue économique, ce souci d'équilibre a pris en compte les capacités du marché publicitaire à financer de nouvelles chaînes gratuites et la nécessité de proposer un nombre significatif de chaînes payantes proposant une variété de thématiques et de formats.
Depuis lors, plusieurs faits nouveaux sont intervenus.
De nouvelles perspectives de recettes publicitaires
pour la télévision
Le décret du 7 octobre 2003 établit le calendrier d'ouverture à la publicité télévisée des secteurs de l'édition littéraire, de la presse et de la distribution. Quelques mois après l'ouverture dont il bénéficie désormais, le secteur de la presse représente près de 2 % des investissements publicitaires bruts en télévision (source TNS Secodip). A compter du 1er janvier 2007, le secteur de la distribution sera autorisé à diffuser de la publicité sur les chaînes nationales diffusées par voie hertzienne, ce qui pourrait représenter en année pleine un gain de plus de 200 M (estimations des sociétés Carat Expert et Initiative Media) pour le marché publicitaire de la télévision.
Les choix du Gouvernement
Par lettre adressée au Conseil le 17 décembre 2003, le Gouvernement a précisé le périmètre du secteur public en indiquant que, sur les 3 canaux prévus initialement, un seul ferait l'objet du droit de priorité accordé à ce secteur, celui bénéficiant à la chaîne Festival. Cette décision réduit l'offre gratuite initialement prévue par le Conseil.
Le droit pour un même groupe à être titulaire d'un nombre
maximal de sept autorisations nationales en TNT
L'article 41 de la loi de 1986 a été modifié par les dispositions de la loi du 9 juillet 2004. Il porte de cinq à sept le nombre maximal d'autorisations relatives à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement.
Le coût des équipements de réception
Les données disponibles les plus récentes en provenance des industriels établissent que les prix de détail prévus pour les terminaux d'entrée de gamme donnant accès à l'offre gratuite de la TNT sont divisés par trois par rapport aux hypothèses retenues au lancement de l'appel à candidatures du 24 juillet 2001. Ils sont passés de 150 à 50 , levant un des obstacles à une initialisation rapide de l'offre de télévision gratuite.
3 - L'objet de la consultation
L'annulation par le Conseil d'Etat des autorisations relatives à i-Télé, Sport+, Planète, Ciné-Cinéma Premier, Canal J et iMCM rend disponible une fraction de la ressource radio-électrique (4 canaux du multiplex R3 et 2 canaux du multiplex R2).
En revanche, les autres autorisations délivrées aux éditeurs le 10 juin 2003, ainsi que les autorisations délivrées le 22 octobre 2003 aux sociétés de multiplex ne sont pas affectées par la décision du Conseil d'Etat.
Dans la mesure où la décision du Conseil d'Etat concerne le quart de la capacité délivrée en 2003 au secteur privé, l'impact sur le marché peut s'avérer important, ce qui justifie l'ouverture de la présente consultation.
Cette dernière intervient en effet en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004 qui dispose que "si les décisions d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique".
L'appel aux candidatures que le CSA prévoit de lancer à l'issue de la consultation, et dont les principes directeurs figurant en annexe font également l'objet de cette consultation, portera sur l'utilisation de la ressource pour la diffusion de services de télévision nationaux.
C'est dans ce contexte et compte tenu de ces nouvelles caractéristiques que le Conseil ouvre la présente consultation et souhaite recueillir l'opinion des acteurs sur les utilisations envisageables de la ressource radio-électrique disponible, et notamment sur une évolution possible de l'équilibre entre services gratuits et services payants, ainsi que sur une possible évolution de l'équilibre des différentes thématiques offertes, tels que ces équilibres résultaient des décisions d'autorisation publiées le 12 juin 2003.
Le Conseil invite l'ensemble des intervenants du marché à lui faire part de ses commentaires.
Les contributions devront être adressées avant le 1er décembre 2004,
- soit par voie postale à l'adresse suivante :
Conseil supérieur de l'audiovisuel
Consultation publique du 22 octobre 2004
39-43 quai André-Citroën
75739 PARIS CEDEX 15
- soit par mél : consultation.tnt@csa.fr
- soit par porteur, à l'adresse suivante :
Conseil supérieur de l'audiovisuel
Consultation publique du 22 octobre 2004
7-11 quai André-Citroën
75739 PARIS CEDEX 15
Les réponses seront considérées comme publiques à l'exception des parties dont la confidentialité sera expressément demandée. Le CSA rendra publique une synthèse des réponses à la consultation.
Téléchargez ci-dessus le document TNT : principes directeurs du futur appel aux candidatures
Vous pouvez consulter également :
- la lettre adressée le 19 octobre 2004 par le Conseil au Premier ministre ainsi que le document TNT : quelle norme pour quel modèle ?
- le dossier complet sur l'arrivée de la télévision numérique de terre.